Les compétences
acquises grâce à des parcours souvent individuels (stages de formation continue, travail
sur le terrain, lectures personnelles,...) constituent un capital unique.Ne pas les valoriser ou ne pas les exploiter représente
aujourd'hui un véritable "gâchis".
Selon la quasi totalité des cadres en poste, le
système actuel ne reconnaît pas suffisamment ces compétences et ne sait pas comment les
réinvestir.
 Reconnaître et réinvestir
: une priorité
Reconnaître et réinvestir
: une priorité
Reconnaître et réinvestir le potentiel que
représentent les compétences acquises par les cadres détachés répond à une triple
nécessité :
1 - rester compétitif dans un contexte international complexe,
2 - répondre aux besoins récents d'une société civile amenée de plus en plus à
travailler avec des partenaires étrangers,
3 - contribuer à développer l'image de professionnalisme émanant du Ministère des
Affaires étrangères.
 L'évolution du contexte
international
L'évolution du contexte
international
Le temps est révolu où la coopération
internationale pouvait se ramener aux seules coopérations bilatérales entre pays. Face
à la multiplication des acteurs et des sources de financement de la coopération
internationale, on assiste aujourd'hui à une véritable explosion des acteurs et des
actions de coopération.
Cet accroissement continu des moyens humains et
financiers mis au service de la coopération internationale signifie que le temps n'est
plus où celle-ci pouvait se contenter d'un certain amateurisme : les enjeux
politiques, économiques et budgétaires qui la sous-tendent poussent les grands
organismes, les agences, et en France les administrations, les collectivités locales, les
fédérations professionnelles, les chambres de commerce, à disposer de personnels doués
de compétences professionnelles reconnues.
Dans ces conditions, on imagine mal que le
Ministère des Affaires étrangères soit la seule institution qui fasse l'impasse sur les
compétences professionnelles des personnels culturels et de coopération. A l'avenir, une
telle position serait d'autant plus curieuse que le Ministère des Affaires étrangères a
vocation à orienter et à coordonner la diversité des initiatives bilatérales tout
en inscrivant son action dans le cadre des programmes multilatéraux.
 Les systèmes
"concurrents" de coopération
Les systèmes
"concurrents" de coopération
L'appréhension du fonctionnement de la
coopération peut être favorisée par l'examen des autres systèmes : quelles réponses
apportent-ils aux nouveaux enjeux en termes de profil de compétences et de gestion de
carrière des cadres détachés ?
Une enquête approfondie sur le fonctionnement
des systèmes de coopération de nos principaux «concurrents» sera entreprise par
l'ACAD-MAE dès la rentrée 1994. Cette étude devrait permettre en particulier
d'effectuer une comparaison entre l'efficacité des différents systèmes et le mode de
gestion de leur personnel.
Sans attendre, il est intéressant d'examiner les
système de coopération britannique et allemande.
La coopération britannique
Tout d'abord, il faut souligner que le British
Council couvre un très large éventail d'activités, comprenant non seulement les relations
culturelles et scientifiques mais aussi, dans les pays en développement, la gestion
de nombreux programmes de coopération technique. Ceci nécessite parmi son personnel
une très grande variété d'aptitudes et de connaissances spécialisées et un nombre
relativement important d'employés dans ses services en Grande Bretagne.
L'Overseas Service est considéré comme l'un des points forts du British Council.
La concurrence pour y entrer est sévère et fournit au Council un noyau de personnel
permanent soigneusement sélectionné et disponible pour servir partout dans le monde
selon les besoins du service. L'âge moyen de recrutement est autour de 30 ans mais il n'y
a pas de règles strictes. Les nouvelles recrues peuvent apporter ou développer des
spécialités relatives aux activités du Council ainsi que des connaissances
géographiques ou linguistiques mais doivent toutes avoir le potentiel pour accéder
éventuellement aux postes de dirigeants. Elles suivent régulièrement des stages de
formation à la fois pour développer leurs compétences de gestionnaire et acquérir les
aptitudes requises pour les postes auxquels ils sont nommés.
Ainsi un cadre du Overseas Career Service occupe
environ trois ou quatre postes en dehors de la Grande Bretagne—chacun d'une durée
moyenne de quatre ou cinq ans— avant de devenir directeur d'un bureau à l'étranger.
Il passe en règle générale les deux tiers de sa carrière dans des postes à
l'étranger et un tiers dans des postes en Grande Bretagne, mais là encore il n'y a pas
de règles fixes. Bien que quelquefois certains soient détachés auprès d'autres
administrations, ils n'occupent jamais de postes dans les ambassades autres que ceux de
conseillers ou d'attachés culturels. De la même façon, le personnel du Foreign Office
ne sert jamais dans les postes culturels.
Malgré ses avantages, l'Overseas Career Service
connaît aussi des problèmes. Tout d'abord, le nombre limité de postes ne facilite pas
la progression des carrières. Ensuite, comparé au service diplomatique, les postes à
haute responsabilité sont relativement moins nombreux, la promotion étant souvent ainsi
restreinte en fin de carrière. Enfin, les familles sont de moins en moins disposées à
accepter l'obligation de mobilité totale.
La coopération allemande
L'administration centrale du Gœthe-Institut
située à Munich reçoit en moyenne entre 700 et 1000 candidatures par an.
Pour être valides, les candidatures doivent en
règle générale, remplir les conditions suivantes :
-Formation Universitaire : minimum Magister/Diplom (Bac + 5) ou Staatsexam/
Referendariat (Bac + 7)
-Expérience professionnelle acquise soit dans l'enseignement (lycée ou université),
soit dans le secteur culturel
-Expérience à l'étranger : les candidats doivent pour la plupart avoir passé une
partie de leur vie à l'étranger.
L'âge moyen des candidats se situe entre 30 et
35 ans.
Après étude des dossiers, environ 350 candidats
sont invités à un entretien avec deux représentants du Gœthe-Institut.
Les candidats retenus après cet entretien sont
invités à participer à un séminaire d'information et de sélection. Quatre à cinq
séminaires sont organisés chaque année, comprenant chacun environ 25 personnes. Lors de
ce séminaire d'une durée de quatre jours, les candidats reçoivent un certain nombre
d'informations sur le fonctionnement du Gœthe-Institut et parallèlement subissent
un certain nombre de tests (dynamique de groupe, tests psychologiques...).
Trois à cinq candidats par séminaire sont alors
définitivement sélectionnés pour bénéficier de la formation interne au
Gœthe-Institut. Ils reçoivent pendant leur temps de formation une allocation
financière prise en charge par le Gœthe-Institut.
Formation
La formation comprend essentiellement 7 étapes :
1) Introduction (1 semaine)
Connaissance de base sur les droits, les devoirs
et les responsabilités d'un membre du Gœthe-Institut.
2) Introduction à la spécialité Allemand Langue Étrangère (10 à 11 semaines)
Théorie et pratique de l'enseignement d'une
langue étrangère. Didactique, analyse des manuels d'enseignements,
"Hospitation".
Préparation au stage dans un Institut en Allemagne.
Informations sur l'administration de ces Instituts, relations avec l'Administration
centrale...
3) Stage dans un Institut en Allemagne (Inlandspratikum 4 mois)
En règle générale, deux stagiaires sont
formés en même temps dans un Institut. Formation à l'enseignement de l'Allemand. Stage
pratique de l'enseignement de l'Allemand (en général niveau débutant) au maximum 16
heures par semaine. Initiation aux autres tâches d'un Institut (programmation culturelle,
activités annexes, suivi des élèves...).
Initiation aux aspects administratifs du
fonctionnement d'un Institut.
4) Stage à l'Administration centrale (2 semaines)
Informations sur les relations entre les
Instituts nationaux, les Instituts à l'étranger et l'Administration centrale. Rédaction
d'un court rapport de stage.
5) Introduction au travail du Gœthe-Institut à l'étranger (1 mois)
Informations sur la programmation, l'organisation
et la réalisation des manifestations. Relations avec les partenaires pour le travail à
l'étranger, autres organismes publics (Internationes), Ministère des Affaires
Étrangères, Direction culturelle des municipalités. Relations avec les artistes, les
critiques, etc.
6) Stage à l'étranger (3 mois)
Apprentissage du travail à l'étranger à
travers l'exemple d'un Institut. Participation à l'ensemble de ses activités: activités
culturelles, service pédagogique, cours d'Allemand, bibliothèque, administration.
Méthode du "learning by doing". Rédaction d'un rapport de fin de stage
comprenant une évaluation du travail de l'Institut en fonction des données du pays
d'accueil et de la conception locale/régionale.
7) Spécialisation Allemand Langue Étrangère (3 semaines)
Réflexion et historique des méthodes de
l'enseignement des langues étrangères. Familiarisation avec les nouvelles méthodes
d'enseignement (travail avec l'image: vidéo, films...). Information sur les examens et
tests d'évaluation.
Préparation à l'activité ultérieure dans un
Institut en Allemagne qui constituait le début imposé d'un "Dozent" au
Gœthe-Institut.
A l'issue de la formation, selon le nombre de
postes disponibles et selon ses résultats, le candidat peut alors être définitivement
engagé par le Goethe-Institut.
 Un double avantage pour le
Ministère des Affaires étrangères
Un double avantage pour le
Ministère des Affaires étrangères
Le système actuel souffre à deux endroits :
—il décourage les agents les plus performants dont les compétences ne sont pas
valorisées à leur retour et qui se retrouvent désavantagés par rapport à leurs
collègues qui auront, eux, bénéficié de promotions internes et occupé les postes les
plus intéressants.
—il pousse certains agents à tenter de rester «coûte que coûte» à
l'étranger
Une connaissance fine et actualisable des
compétences de ses agents en poste présenterait un double avantage pour le Ministère
des Affaires étrangères :
—la gestion des personnels, fondée, entre autres, sur l'évaluation des
compétences, constituerait un outil de pilotage du système et permettrait d'impliquer
des personnes dont le profil serait mieux adapté à la situation,
—la constitution au sein du Ministère des Affaires étrangères d'un vivier de
compétences professionnelles reconnues et mises à la disposition de la société civile
contribuerait à renforcer l'influence de celui-ci dans la coopération internationale.
 Un gain pour la société
civile
Un gain pour la société
civile
De nombreux organismes français (Collectivités
territoriales, Universités, Organismes déconcentrés de l'Etat, Centres de Recherche et
de Formation...) ressentent la nécessité d'employer des personnels qualifiés pour
développer leur coopération internationale; connaissent-ils toujours l'existence et
la réalité des compétences des cadres détachés auprès du Ministère des Affaires
Étrangères ?
La spécificité professionnelle des
personnels détachés auprès du Ministère des Affaires étrangères pour exercer des
fonctions de cadre dans les milieux culturels et pour le développement doit être mieux
connue. L'idée du travail de ces "fonctionnaires de l 'étranger" relève trop
souvent d 'une mythologie, d 'une image de roman de gare.
Aujourd'hui, au terme de sa mission, un agent est
tout simplement réaffecté au sein de son administration d'origine, sans qu'il soit tenu
compte de ses nouvelles compétences. Cela représente aussi bien pour l'intéressé que
pour la société civile un gâchis extrêmement regrettable
 Reconnaître, oui mais
comment ?
Reconnaître, oui mais
comment ?
 Une formation qualifiante
Une formation qualifiante
A l'exception notable des compétences en langues
étrangères, l'ensemble des formations suivies au cours de la "carrière" ne
donne lieu pour l'instant reconnaissance, à aucune certification officielle de
l'Administration.
Des compétences non reconnues... faute
d'être connues... Dans la pratique il a été particulièrement difficile de faire valoir
les compétences, non qu'elles soient insuffisantes ou inadaptées, mais en raison de l'absence
de reconnaissance des formations et des expériences acquises dans le cadre des
différentes missions auprès du Ministère des Affaires étrangères; tout
particulièrement au niveau de mon ministère d'origine : les dizaines de stages
encadrés, la gestion d'équipes de plus de cinquante personnes ou d'enveloppes
budgétaires importantes, l'organisation de séminaires de haut niveau, la gestion de
projets de coopération linguistique ou culturelle, les actions de production,
d'encadrement ou d 'animation n'avaient aucune valeur, seuls comptaient ma formation
initiale et mon grade.
Pourquoi ne pas valoriser les années passées à
l'étranger et l'expérience acquise sous la forme d'une attestation ou d'une
certification (sorte de capital-points) permettant à l'agent détaché d'ouvrir
l'éventail des fonctions qu'il pourrait occuper à son retour.
Sans aller jusqu'à un principe d'unités
capitalisables, la validation des différentes formations suivies par les "cadres
détachés" tout au long de leur "carrière" permettrait au Ministère des
Affaires étrangères de reconnaître les qualités professionnelles de ses agents et
partant, de les affecter sur les postes les plus appropriés, mais aussi aux organismes
français de recruter du personnel qualifié sur des bases clairement établies.
Je suggère que soient multipliées les possibilités de stages très courts
(une ou deux semaines) sur des thèmes suffisamment précis pour être traités
valablement en si peu de temps. Ainsi avec un investissement temps raisonnable, chacun
pourrait, année après année, se bâtir une formation à la carte, collant de
très près à ses besoins.
Un plan d'organisation de ces formations
élaboré par un des adhérents de l'ACAD-MAE a été placé en annexe.
 Réinvestir, oui mais
comment ?
Réinvestir, oui mais
comment ?
 Faciliter la circulation
des compétences
Faciliter la circulation
des compétences
Faciliter l'organisation fonctionnelle de la
mobilité des cadres détachés entre l'étranger et la France, et la France et
l'étranger, grâce à un système d'alternance et de permutation doit permettre :
—de placer en France sur des postes-clefs de relations internationales dans les
régions, les universités, les collectivités territoriales, des agents compétents,
porteurs de la culture et du "label Affaires Étrangères" et qui sauront
entretenir des collaborations privilégiées avec ce Ministère;
—de donner l'irremplaçable expérience du terrain aux responsables des relations
internationales d'institutions françaises intéressées par la coopération.
Recrutement en France de responsables de relations internationales.
Beaucoup d'établissements et d'entreprises auraient besoin d'approches moins empirique
en la matière.
Tous les ministères, agences, organismes publics, collectivités territoriales,
universités devraient avoir des «chargés de mission» ayant une expérience dans ce
domaine.
Il faut dépasser la logique administrative
détachement/réintégration et aller vers une cohérence de l'alternance entre les
missions à l'étranger et celles accomplies en France au sein du Ministère des Affaires
Étrangères, d'autres Ministères, de collectivités locales ou d'autres organismes.
La création récente au sein de la Direction de
la Coopération Culturelle et Linguistique d'un bureau "retour-mobilité" doit
être considérée comme un élément essentiel pour la réussite de cette politique de
circulation des compétences.
Ce service est en particulier chargé d'aider les
agents à préparer leur retour en France, mais aussi de favoriser les échanges entre les
organismes culturels, scientifiques, techniques et éducatifs ayant en France une
politique de relations internationales et les postes diplomatiques à l'étranger.
 Favoriser l'échange
d'informations
Favoriser l'échange
d'informations
Compte tenu de l'ampleur du problème et des
enjeux, 1'ACAD-MAE propose que soit mis en place un Institut des Relations Culturelles et
de la Coopération qui recenserait à la fois les besoins du Ministère et ceux des
partenaires français concernés, et contribuerait à une meilleure synergie des efforts
mis en place en amont. Cette proposition figure dans les conclusions de nombreux rapports
et audits.
En effet, si un véritable "Institut de la
Coopération" voyait le jour, il est certain que nombre d'agents, de retour de
l'étranger, pourraient à la fois contribuer à la formation des futurs coopérants, mais
également continuer à exercer ce métier en France, métier pour lequel le Ministère a
énormément investi mais dont les retombées en termes de réemploi de compétences sont
mal exploitées à l'heure actuelle.
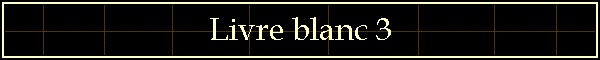

![]()